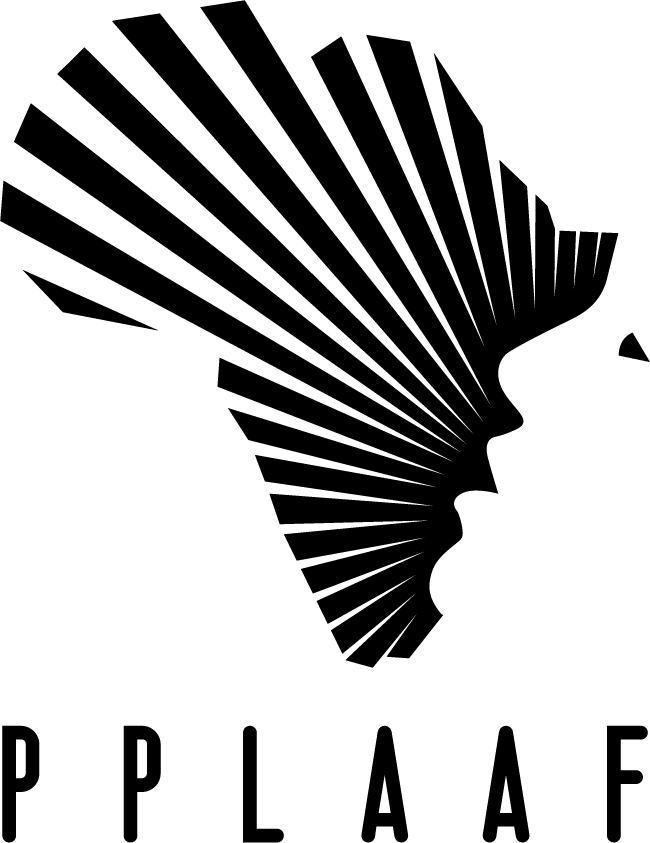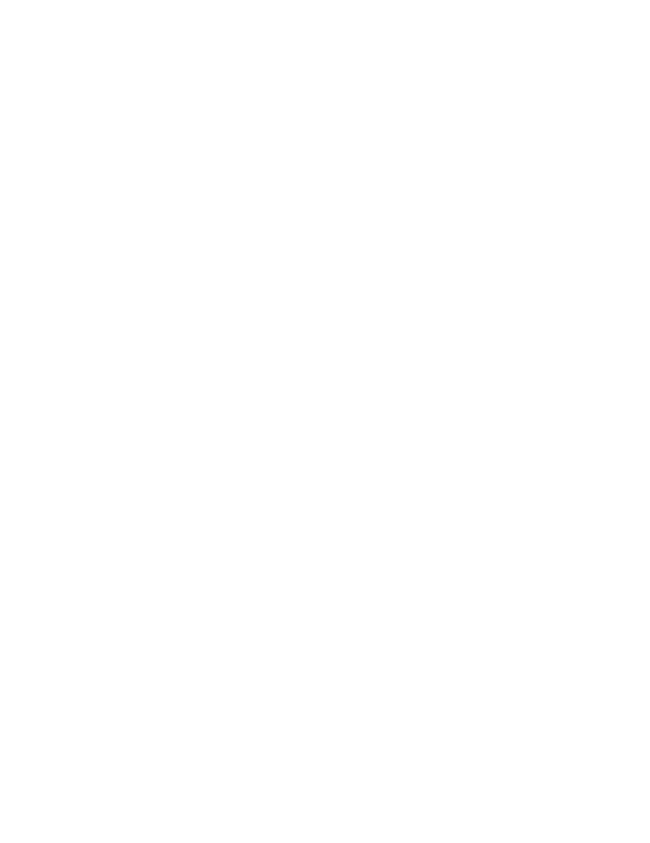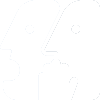Publié en 2021
Législations pertinentes
- Constitution de la République démocratique du Congo (2011)
- Code du Travail (2002)
- Code Penal Congolais (2004)
- (Loi Portant Interdictions de Discours et Messages Dangereux dans la Presse)
- (Loi Portant Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux et le Financement du Terrorisme)
- (Loi Portant Protection de l’Enfant)
- (Loi no 96-002 du juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la Liberte de Presse)
- (Proposition de Loi Relative a l’Access a l’Information)
Résumé
Les protections juridiques pour les employés et les citoyens qui dénoncent la criminalité, la corruption et les fautes graves en RDC sont pratiquement inexistantes. Les quelques protections existantes sont faibles, à la fois, en termes de législation et d’applicabilité. En conséquence, les lancements d’alerte sont exposés à toute sorte de représailles.
Les protections offertes aux lanceurs d’alerte sont limitées aux représailles liées au licenciement professionnel dont ils pourraient faire l’objet. Aucun canal officiel pour déposer une plainte n’est disponible et les autres formes de représailles ne sont pas couvertes.
Les libertés des médias, tout en étant garanties par la Constitution, sont limitées dans la pratique. Les journalistes subissent des menaces, des actes d’intimidation, des violences et des arrestations. De même, les civils bénéficient du droit à la liberté d’expression et d’association, cependant les violentes répressions contre les manifestants et la détention de nombreux détenus politiques par le passé démontrent que ces droits ne sont pas respectés.
Malgré le manque de protection juridique et un climat de peur répandu dans la société, les congolais sont de plus en plus nombreux à faire preuve de courage et à lancer l’alerte sur la corruption dont ils sont témoins. Plusieurs cas de lanceurs d’alerte peuvent être cités ; Jean Jacques Lumumba, Israël Kaseya, Gradi Koko, Navy Malela ou encore Claude Mianziula. Par ailleurs, face à l’ampleur du phénomène dans le pays, le Président Félix Tshisekedi a affirmé sa volonté d’adopter une loi de protection des lanceurs d’alerte.
Lois et mesures relatives aux lanceurs d’alerte
La RDC manque de lois et de politiques sur les lanceurs d’alerte. La seule protection disponible pour les lanceurs d’alerte est consacrée par le Code du travail. Le présent code s’applique à « tous les travailleurs et à tous les employeurs » et dispose que le dépôt d’une plainte ou la participation à une procédure contre l’employeur pour des violations présumées de la loi ne constitue pas un motif de licenciement. Les travailleurs qui ont été injustement licenciés ont droit à la réintégration ou aux dommages-intérêts fixés par le tribunal du travail en fonction de la nature des services accomplis et de l’ancienneté du travailleur, mais limitée à 36 mois du salaire le plus récent du travailleur. Un inspecteur du travail externe et neutre est chargé d’enquêter sur les plaintes concernant les violations des lois du travail. Ils sont tenus de traiter la source des plaintes de façon « absolument confidentielles » et de s’abstenir de révéler que l’inspection procède d’une plainte. Toutefois, l’efficacité de ces inspecteurs est limitée par une formation insuffisante et le manque de ressources.
Aucune protection légale et peu de canaux existent pour que les citoyens puissent signaler tout type de faute. Deux exceptions sont à relever.
La première est la mise en place d’une unité de renseignement financier dans le cadre de la politique de tolérance zéro du gouvernement contre la corruption (la Cellule Nationale des Renseignements financiers CENAREF). Le mandat de cette unité consiste à recevoir, analyser et traiter des informations financières pour établir l’origine des transactions ou la nature de l’objet des déclarations de soupçon du contribuable. La CENAREF reçoit des informations auprès des organismes gouvernementaux, y compris les juridictions et l’Agence nationale de renseignement, ainsi que des sources anonymes. Cependant, il existe une « forte perception » que la CENAREF n’est pas en mesure d’enquêter sur les entreprises et les transactions impliquant des hauts fonctionnaires et les élites dirigeantes congolais.
Dans le cadre de sa politique de lutte contre la corruption, le nouveau président Tshisekedi a mis en place l’Agence de prévention et de lutte contre la corruption (APLC). Son mandat lui permet d’analyser, d’examiner et d’étudier tout soupçon, acte, information ou rapport relatif à la corruption, au blanchiment des capitaux et/ou à des infractions similaires. Pour cela, l’article 3 de l’ordonnance portant création de l’APLC prévoit que l’Agence est chargée de prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer une protection efficace des témoins et des experts contre les représailles ou les actes d’intimidation. Des précisions quant aux dispositions qui doivent être prises pour protéger un lanceur d’alerte ne sont pas données. Des mesures de protection prises par l’Agence ne sont pas encore connues.
Un an après sa création, le bilan de l’Agence est mitigé. Les résultats concrets ne sont pas encore visibles et l’APLC a elle-même fait l’objet de certaines accusations, puisque des membres de l’Agence auraient reçus des sommes importantes en liquide.
Diverses autres lois, y compris la loi contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la loi sur la protection de l’enfance, obligent les citoyens à signaler une faute, en défaut de quoi ils sont susceptibles de poursuites. Cependant, aucune protection n’est prévue pour ceux qui dénoncent ces inconduites.
Faiblesses et réformes requises
La RDC souffre d’un manque presque total de lois visant à protéger les lanceurs d’alerte. Les employés ne sont protégés que contre les cas de licenciement abusif, alors que les citoyens ne connaissent pas la protection qui leur sera accordée, ou même si une protection leur sera reconnue contre les représailles s’ils signalent toute forme d’inconduite. La Constitution de la RDC ne reconnaît à de telles personnes, comme les lanceurs d’alerte, aucune légitimité, de sorte qu’aucun mécanisme juridique n’est prévu pour leur protection.
En outre, l’organisme gouvernemental qui reçoit et enquête sur les rapports des lanceurs d’alerte dans les lieux de travail est sous-financé, ses pouvoirs limités et ses membres sous-formés. Aucune agence n’est disponible pour appuyer ou fournir des conseils juridiques aux lanceurs d’alerte.
Conformément aux normes internationales, une législation exhaustive concernant les lanceurs d’alerte, ainsi qu’un organisme d’exécution compétent, devraient être établis en RDC. Dans cette perspective, le président Tshisekedi a assuré, dans une allocution du 6 décembre 2020, vouloir adopter un dispositif légal reconnaissant et protégeant les lanceurs d’alerte. Cette législation devra prévoir une protection juridique contre les poursuites qui pourraient être lancées contre les lanceurs d’alerte. Après les révélations faites sur Dan Gertler et la banque Afriland First Bank CD, les lanceurs d’alerte ayant fourni les informations ont été poursuivis devant les tribunaux. Ces poursuites ont même conduit à la condamnation à mort des lanceurs d’alerte le 7 septembre 2020 devant le tribunal de Kinshasa. Ces hommes se trouvent condamnés pour avoir dénoncé des pratiques de corruption et n’ont pas eu l’opportunité de se défendre. Aussi, la réforme du cadre législatif doit revenir sur les lois de confidentialité en vigueur en RDC. Ces dernières prévoient de lourdes peines pour les auteurs de divulgations d’information et ne mettent pas en balance l’intérêt général. La législation ne doit pas laisser le principe de confidentialité primer sur l’intérêt de la population congolaise. Enfin, les dangers auxquels font face les lanceurs d’alerte sont nombreux. Plusieurs sont menacés de mort et doivent quitter le pays. Ainsi, des ressources considérables doivent être mises en place pour assurer l’intégrité physique des lanceurs d’alerte. Ces derniers ne doivent pas craindre pour leur sécurité pour avoir dénoncé les pratiques illicites dont ils ont été témoins.
Lois de confidentialité
Selon le Code pénal congolais, toute personne qui détient des secrets d’État ou professionnels est passible d’une amende et / ou jusqu’à six mois de prison en cas de publication de ces informations, sauf dans les cas où la loi l’y oblige. Le Code prévoit jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour divulgation au public de toute information militaire relative à la sécurité nationale et jusqu’à dix ans pour possession, reproduction ou autorisation de publier de telles informations. Le Sénat, chambre haute de la RDC, avait approuvé une loi sur l’accès à l’information en 2015. Cette mesure législative devait rendre l’information détenue à tous les niveaux du gouvernement accessible de façon publique et gratuitement. Cependant, l’Assemblée Nationale n’a pas validé le texte et une nouvelle législature a, depuis lors, débuté.
Le texte de 2015 comportait certains défauts sur lesquels il sera nécessaire de revenir dans le nouveau projet de loi. En effet, les agences avaient le droit de retenir un large éventail d’informations, y compris les documents relatifs aux délibérations exécutives, à la sécurité nationale, aux secrets commerciaux, aux données personnelles, aux ressources naturelles et aux enquêtes criminelles. Quiconque divulguait de telles informations pouvait être tenu pour responsable de tout grief qui en résulterait. Il était préoccupant que les ambiguïtés de la loi, associées à cette disposition, pouvaient rendre les agences réticentes à fournir des informations.
Droit des médias et liberté d’expression
Bien que la Constitution prévoit la liberté de la presse, cette garantie est soumise au « respect de la loi, de l’ordre public et des droits d’autrui ». De même, la liberté d’expression est garantie, sous réserve « du respect de la loi, de l’ordre public et de la moralité ». La loi de 1996 sur les modalités de la liberté de la presse note que la liberté d’expression exige le droit d’être informé sans entrave, est soumise au respect de la loi, de l’ordre public et de la moralité. Les publications qui violent cette condition peuvent être saisies et censurées.
Le Code pénal congolais prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes pour diffamation et injures. En droit congolais, la diffamation est interprétée de façon extensive et inclut tout propos, qu’il soit vrai ou faux, imputant publiquement à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de cette personne, ou à l’exposer au mépris public.
La loi sur la liberté de la presse interdit expressément la publication de messages qui portent atteinte à l’« honneur et à la dignité » d’un individu et énonce des « infractions » journalistiques punissables de peines privatives de liberté, notamment en cas d’incitation à la haine et à la discrimination ; publication des délibérations de tribunaux. Les gouvernements nationaux et provinciaux utilisent systématiquement ces lois pour intimider et réprimer les journalistes critiques. Les procès et les recours en diffamation sont tenus devant des tribunaux qui ont parfois des liens étroits avec le gouvernement, et les verdicts reflètent souvent des préjugés politiques. En outre, la législation de 2006 sur « les discours dangereux et les messages dans la presse » interdit aux médias de couvrir tout ce qui pourrait « inciter à la haine, à la désobéissance, à la discrimination … [ou] à un acte ou à un comportement non civilisé ou non civil ». Encore une fois, il est préoccupant que l’ambiguïté de ces lois et les sanctions extrêmes pour les violations entraînent une autocensure de la presse. Les droits des journalistes de protéger leurs sources sont énoncés dans la loi sur la liberté de la presse, mais le sont sous réserve d’exception de cas prévus par la loi.
Le rapport de Freedom House sur la liberté en RDC de 2020 considère le pays comme étant « non libre ». Plus particulièrement, la liberté de la presse reste soumise à de nombreuses restrictions alors même qu’elle est reconnue par la Constitution congolaise. Même si l’année 2020 connait une amélioration des libertés, le rapport démontre que les journalistes continuent d’être la cible de menaces et de détentions arbitraires. En mai 2020, le journaliste Fabrice Ngani a été arrêté pour avoir rédigé une lettre critique au gouverneur de la province Mongala. Libéré en juin, il lui a été interdit d’exercer son métier de journaliste par les autorités provinciales. En décembre 2020, le journaliste de RFI Pascal Mulegwa a fait l’objet de poursuites en diffamation de la part de l’ancien vice Premier ministre des transports, José Makila. Un rapport de l’Observatoire de la dépense publique (ODEP) accusait l’homme politique d’avoir détourné de l’argent pour financer sa campagne électorale. Le journaliste avait rendu compte de ce rapport sur l’antenne RFI ainsi que sur le site internet. Les poursuites engagées à l’encontre du journaliste démontrent clairement la difficulté pour la presse de faire son métier. Les violences persistent alors que le Président Tshisekedi a affirmé vouloir faire des médias un quatrième pouvoir. Reporters Sans Frontières (RSF) attribue à la RDC le 149ème rang sur 180 pays. La situation s’améliore timidement puisque le pays gagne une place depuis 2020. RSF confirme que les journalistes sont exposés à « des menaces, violences physiques, arrestations, longues détentions et parfois même assassinat ». Journaliste en danger, l’organisation partenaire de RSF en RDC, recense ainsi 116 exactions pour l’année 2020.
Cas de lancements d’alerte
Depuis 2016, la RDC connait plusieurs cas de lancements d’alerte. Jean Jacques Lumumba, petit-neveu du héros de l’indépendance Patrice Lumumba, était un cadre dirigeant de la banque congolaise BGFI. Lorsqu’il découvre en 2016 des transactions suspectes de plusieurs millions de dollars entre la banque et des proches du président de l’époque, Joseph Kabila, Lumumba tente de prévenir ses superviseurs. En réponse, il sera menacé avec une arme à feu. Il quittera alors son pays. Les documents qu’il divulguera, les Lumumba Papers, mettront en lumière l’implication de la banque dans la corruption, le financement illégal et le détournement de fonds ainsi que des transactions suspectes avec la Commission électorale nationale indépendante.
En 2018, c’est au tour de Gradi Koko et de Navy Malela de dénoncer les mauvaises pratiques de leur banque. Respectivement chef de mission audit interne et auditeur interne, ils travaillaient pour la filiale congolaise de la banque Afriland First Bank à Kinshasa. D’abord habités par des soupçons suite à l’ouverture et la gestion atypique de certains comptes, ils mènent l’enquête et découvrent les dépôts d’espèces anormalement importants, se chiffrant à plusieurs centaines de milliers voire millions de dollars ou d’euros sur ces nouveaux comptes. Gradi Koko alerte sa hiérarchie et se retrouve, comme Lumumba, menacé : « tu pourrais te faire abattre à la sortie de la banque ». Les documents divulgués ont permis la rédaction du rapport par PPLAAF et Global Witness, « Des sanctions, mine de rien ». Ce rapport dénonce les pratiques de Dan Gertler dans le secteur minier en RDC alors même qu’il était sous sanctions américaines.
Aujourd’hui réfugiés en France, les deux lanceurs d’alerte ont appris, lors d’une conférence de presse à Kinshasa tenue le 25 février 20201 par les avocats de la banque, leur condamnation à mort par contumace par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa le 7 septembre dernier pour des faits de vol et d’association de malfaiteurs. Cette condamnation a été vivement dénoncée, notamment par les ambassades américaines, françaises, et belges à Kinshasa, ainsi que par les Nations-Unies et par des ONG, parmi lesquelles UNIS, Whistleblowing International Network, Transparency International, et une cinquantaine d’autres organisations, qui ont écrit une lettre ouverte au Président Félix Tshisekedi réclamant un cadre légal et institutionnel pour le statut de lanceur d’alerte ainsi que des mesures de protection immédiates pour les deux lanceurs d’alerte menacés.
La lettre ouverte reprend également le cas de Claude Mianziula. Expert en évaluation de diamants brut dans la ville de Mbujimayi, Claude Mianziula a dénoncé les malversations qui prenaient place au sein de la société minière de Bakwanga. Alors qu’il avait évalué un diamant à 2.30 carats, le diamant Fancy Green, celui-ci disparaissait afin d’être remplacé par une pierre de moins grande valeur marchande. Finalement, et cela afin d’intimider Mianziula, une plainte est déposée contre lui pour imputations dommageables et injures publiques. Dans le cadre de cette plainte, il passera 55 jours en prison.